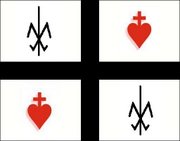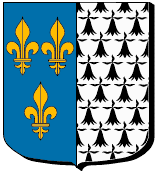Démocratie… Jamais peut-être autant qu’aujourd’hui il n’a importé que ce mot fût défini pour qu’on n’en jouât plus.
M. Frossard atteste les poètes et les philosophes. C’est beaucoup et c’est peu. M. Paul-Albert Robert, professeur honoraire à la Faculté libre de droit de Marseille, a écrit, dans une lettre au Temps, lettre pleine d’excellents arguments contre le régime électif, cette opinion très personnelle, que l’Eglise a su « réussir pleinement la solution de ce délicat problème : faire surgir l’autorité suprême de la démocratie… » Voyons, pourquoi ne pas être exact ? Ce qui surgit d’autorité dans l’Eglise ne vient pas de la démocratie, puisque cela ne sort nullement d’un peuple-roi mais d’un peuple tout court, et d’un peuple d’ailleurs gouverné. Pourquoi confondre les deux termes ? L’un dit : gouvernement du peuple. L’autre dit : condition populaire. Si le peuple catholique régnait, s’il s’agissait à son propos d’une démocratie véritable, le problème serait résolu sans effort (mais au pire sens) et l’autorité (mal constituée, mais constituée) n’aurait pas à « surgir » d’un jeu complexe et alternant de désignation par en haut et d’élection exercée sur un plan déjà patricien.
La démocratie n’est pas le peuple, c’est le gouvernement d’un peuple dont les membres sont comptés un par un : un homme, un vote, cet homme et ce vote étant réputés souverains et créateurs d’une souveraineté soit directe soit déléguée. On sait quel mal cette institution a fait à la Belgique après la victoire de 1918 : on y avait précédemment le vote plural ; le vote plural peut, dans son ensemble, être démophile, ami et bienfaiteur du peuple, son sauveur, son conservateur : il n’est pas démocrate, puisqu’il institue une autorité fondée non sur la quantité, mais sur la qualité, celle de chef de famille, d’époux, de père, de diplômé, de possédant, etc… Les qualités prévalent sur le nombre. En démocratie, le Nombre, par définition, ignore la Qualité, et la façon dont il prévaut sur elle ne naît pas d’une corruption, ni d’une crise, ni d’un abus : il est lié à la logique de son pouvoir.
Dans sa lettre, M. Paul-Albert Robert proteste contre la brigue. Et il a raison. Les beaux temps de la République romaine, patriciens dans l’âme, avaient la brigue en horreur. L’élection vraie, l’élection juste est celle qui n’est pas sollicitée qui jaillit comme un cri public vers le mérite ou la compétence : Ambroise évêque ! Ambroise évêque ! Ce n’est donc pas l’élection démocratique. Celle-ci, non contente de tolérer la brigue, en fait un devoir et une loi : notre scandaleux système de « déclaration de candidature », établit après le Boulangisme, interdit aux électeur d’aller spontanément, librement, naturellement, à l’homme de la circonscription qu’ils savent apte à les servir ; il faut que celui-ci soit allé dire à Monsieur le Préfet : je suis candidat. Quelle honte ! Mais quel aveu ! La démocratie bénéficie de l’ambition des candidats comme de la compétition des partis. Elle vit de cela, et de cela seul.
Certains auteurs, et des plus grands, entre les Maîtres de jadis, ont paru se montrer moins radicalement hostiles à la démocratie. L’autorité d’Athènes, dont l’histoire ne laisse pas d’être cruellement exemplaire, semble avoir fait hésiter un Aristote si rigoureux d’ordinaire. Il faut avouer que sa Politique n’est pas exactement le Traité de la science de la durée et de la prospérité des Etats ; il y manque, en plus d’un endroit, des distinctions indispensables. Le droit, le devoir, l’utile, le nécessaire, y semblent parfois confondus. Tels de ses disciples, comme saint Thomas d’Aquin sont bien plus nets. Non partout : son De Regimine Principum est un traité de l’action politique, c’est-à-dire d’une action qui ressortit, comme toute action, à l’éthique ; il ne traite pas de la STRUCTURE des Etats politiques. La Somme est autrement instructive à cet égard. Mais, de toute évidence Bossuet est en progrès sur Saint Thomas, comme Bonald sur Bossuet et notre La Tour du Pin sur Bonald. Sans la moindre foi au progrès, l’on est bien obligé d’avouer que des travaux persévérants conduits dans le même sens par des générations de hautes intelligences nourries des mêmes principes, dévoilent et dégagent de croissantes lumières.
Leur Père à tous, Aristote, paraît même en progrès sur lui-même quand on compare à sa Politique, défectueuse par moments, la lumineuse monographie découverte en 1890, intitulée : la Constitution d’Athènes, que d’autres traduisent : la République des Athéniens, où la matière proprement politique est distinguée par l’analyse philosophique de l’histoire, et isolée des questions latérales tirées de l’impératif moral. Bien que la déontologie médicale doive se mettre en règle avec le décalogue, il ne faut pas mêler les affaires d’éthique à des affaires d’anatomie. Ce petit livre inestimable, bienfait posthume d’Aristote à ses arrière-neveux, mériterait d’être lu et médité par les esprits que préoccupe le problème de la démocratie. Il fut l’objet d’un cours à l’Institut d’Action française de 1906, dans une chaire dite de l’Empirisme organisateur : c’est un des plus beaux souvenirs de notre jeunesse, alors expirante, et quels amis n’y voyons-nous pas assis sur le même banc,- de Lucien Moreau et de Jacques Bainville à Léon de Montesquiou, à Robert de Boisfleury, à Pierre Gilbert !
Il faudrait donc que cela serve. Répétons que la démocratie est la grande créatrice, excitatrice et stimulatrice de ce mouvement collectif, dénommé la lutte des classes. Je ne comprends pas comment M. Frossard peut opposer à cette évidence les réflexions marxistes sur « le patricien et le plébéien de l’ancienne Rome ». Car elles la confirment.
Très précisément, les conflits sociaux gréco-romains, les longues guerres des pauvres contre les riches, et la destruction de la Cité et de la Ville sont sortis de la démocratie. Avant elle, la coopération des classes se faisait tant bien que mal. Après elle, de cette démocratie politique et de son parti sortit l’institution canonique de leurs rivalités d’intérêt. Celles-ci auraient pu exister, mais elles auraient pu aussi ne pas exister, suivant le cas, les circonstances, les évènements… La démocratie les a rendues nécessaires.
Cela de tous temps. Il y eut des heures où les ouvriers du cuir de Limoge ont voulu obtenir des patrons du cuir un salaire supérieur ; il sonna d’autres heures où les mêmes ouvriers et les mêmes patrons, menacés par des industriels tchécoslovaques, ont fondé, toujours à Limoges, une entente sur le commun intérêt de leur travail, bien supérieur aux antagonismes de leurs classes. Cette union est naturelle dans un pays non démocratique. Elle est particulièrement difficile quand un pays comme le nôtre ou comme Rome décadente, est doté du régime politique du Nombre et de son vote : les partis naissants cherchent et trouvent dans les classes rivales ce qu’on peut appeler l’eau mère de leur cristal. Ce qui était accidentel, et fortuit, l’antagonisme social, devient régulier et constant, en vertu de la structure légale de la cité. C’est d’elle, en conséquence, que le mal vient ou, si l’on veut, qu’il devient mal chronique et constitutionnel. Un socialisme sans démocratie peut aboutir à une organisation nationale et sociale du travail. Le socialisme démocratique va, court, se précipite à la lutte des classes prolongée jusqu’à leur ruine. Comme la démocratie produit dans l’Etat absolument les mêmes effets que dans la société, elle est bien le mal et la mort. Une République peut être en règle avec les lois de la durée et de la prospérité des peuples, une Démocratie jamais.
On a vu de grandes Républiques durer et croître du moment qu’elles étaient en conformité avec les conditions héréditaires de la vie des Etats : leurs pouvoirs collectifs ont été longtemps productif et florissant. Cela ne s’est vu d’aucune Démocratie. Tous leurs débuts ont coïncidés avec la consommation et la dissipation des ressources, la dégradation et l’exagération de l’autorité, l’affaiblissement de l’Etat, et les empiètements de l’Etatisme, avec la centralisation en même temps que la décomposition. Les peuples les mieux doués, les pays les plus favorisés, ont tous reçu de la démocratie le même souffle de décadence qu’elle a répandu chez nous entre 1789 et 1939 : il y a le même siècle et demi de cette course à la mort chez le peuple d’Athènes, entre 490, l’année de Marathon, et 338, l’année de Chéronée ; encore, la guerre du Péloponnèse, qui accéléra ce déclin, était de 431 : plus près de la grande victoire que de la défaite définitive.
Encore cette démocratie était-elle tempérée par toute sorte de rudes défenses : esclavage, métèques, tirage au sort des archontes (et non leur élection comme on faisait des stratèges) et le fameux : « Qui est ton père ? Qui est ta mère ? Et le père de ton père ? » La flamme du verbalisme démocratique fut la plus forte que tout et plus destructive. En fait, rien n’a jamais tenu contre cette puissance de mort.
Le Play disait : « La monarchie dans l’Etat, l’Aristocratie dans la Province, la Démocratie dans la Commune. » Erreur patente, il faut le dire avec tout le respect dû à ce maître, erreur née d’une fausse symétrie. Que vaut la démocratie dans la commune ? Nos finances municipales, nos polices municipales, nos convulsions et nos léthargies municipales répondent qu’elle n’y vaut rien, et pis que rien.
L’expérience que la France en a faite est probante. Le Play voulait sans doute dire : République dans la Commune. Mais il savait fort bien que, heureusement pour elles, un grand nombre de petites communes, ayant pour maire un propriétaire terrien, parfois châtelain, sont de menues seigneuries constitutionnelles, qui ne connaissent même pas un statut républicain. Pour les grandes agglomérations, ce sont, ce doivent être des Aristocraties comme les Provinces, mais d’un caractère spécial : la bourgeoisie y est moins différenciée que dans les capitales de provinces, les grandes fortunes y sont moins personnelles, et cette réunion de foyers se rapproche davantage du type communautaire, le nom le dit assez bien, avec son prolongement non moins significatif de biens communaux. La Tour du Pin disait avec raison que la commune est la famille de ceux qui n’en ont pas, il entendait une grande famille au sens historique. Rien de démocratique dans cette commune-là ! Car lorsque la démocratie s’y introduit, avec le souverain suffrage égal et unitaire, on peut dire que ce bon fruit reçoit le ver qui le rongera.
Il me semble difficile de résister à ce corps d’évidences, qu’il serait possible de rendre plus clair encore.
Quant aux censures que les marxistes faisaient de la démocratie, M. Frossard en aurait-il été dupe lui aussi ? Je l’avoue : ce fut mon cas. Il y a fort longtemps et pour un temps très court.
Quelques conversations et quelques lectures de socialisme orthodoxe suffirent à me montrer que, si les Partis et les Classes y étaient hautement préférés aux « grues » métaphysiques dont parlait Paul Lafargue, le gendre de Marx, on n’en considérait pas moins le jeu naturel de la Démocratie comme le grand ressort de la lutte sociale et le meilleur engin qui pût servir aux camarades et aux militants. Preuve : le merveilleux emploi, de plus en plus socialiste, fait des scrutins démocratiques, depuis le retour des communards amnistiés (1880) jusqu’aux élections du front populaire (1936). Et cela se comprend : tout organisateur qu’il se prétende, le socialisme ne veut organiser le travail qu’au profit de l’égalité ; le socialisme marxiste est à fins égalitaires ; il tend à la démocratie politique. Qu’est-ce, au surplus, que l’égalité politique sans égalité sociale ? Une simple fiction. Les deux systèmes se soutiennent partout et ne peuvent se contredire sérieusement nulle part. On n’épurera le socialisme, on ne lui rendra une valeur naturelle et humaine qu’à la condition de le délivrer de toute politique démocratique. Alors, et alors seulement, cet égalitarisme extérieur ayant disparu, on pourra substituer à son égalitarisme intrinsèque les principes d’entr’aide et d’interdépendance qui sont la condition de la vie et des progrès de toute nation.
Le seul mot de démocratie crée un péril pour l’ordre et la paix. A l’exemple de Le Play qui, pourtant fort attentif au vocabulaire, voulut faire dire à ce mot ce qu’il ne dit point, La Tour du Pin eut, un jour, une courte hésitation, il inclina même à cet usage malsain. Armée de son merveilleux petit livre, Aphorismes de sciences sociales, notre jeunesse osa le rappeler à ses propres principes. Il eut la bonté généreuse de s’y rendre comme à la vérité. Pourquoi nos conservateurs et nos nationaux n’ont-ils pas fait comme lui ? Cette joie, ces hautes délices, cette béatitude d’être dans le vrai les auraient certainement consolés du plaisir qu’ils nous auraient fait.
M. Paul-Albert Robert invoque le prestige de l’histoire ecclésiastique en faveur de ce qu’il appelle « démocratique » et qui n’est point démocratique. Est-ce que ces vagues ressemblances, ces reflets approchés de la démocratie, n’ont pas été trop souvent capables d’imposer ou inspirer des déviations dangereuses ?
Comment peut-il bien comparer une grande société d’âmes comme l’Eglise, à nos sociétés charnelles ? Celles-ci ne sont point filles de notre volonté. Elles sortent de notre sang, de notre naissance : natio, le mot le dit. Alors, pourquoi éliminer, par suite d’on ne sait quelle timidité instinctive, le procédé naturel de la transmission du commandement, qui est l’hérédité physique, le même qui sert à transmettre les autres biens ? L’histoire est le panégyrique vivant des monarchies héréditaires, en particulier dans notre France. Quelle phobie en peut éloigner ? Et nos cent cinquante-deux années de démocratie parlementaire ou plébiscitaire sont-elles si brillantes qu’il faille se dire les uns aux autres : Comme on est bien là ! Et comme il fait bon d’y rester !
M. Frossard atteste les poètes et les philosophes. C’est beaucoup et c’est peu. M. Paul-Albert Robert, professeur honoraire à la Faculté libre de droit de Marseille, a écrit, dans une lettre au Temps, lettre pleine d’excellents arguments contre le régime électif, cette opinion très personnelle, que l’Eglise a su « réussir pleinement la solution de ce délicat problème : faire surgir l’autorité suprême de la démocratie… » Voyons, pourquoi ne pas être exact ? Ce qui surgit d’autorité dans l’Eglise ne vient pas de la démocratie, puisque cela ne sort nullement d’un peuple-roi mais d’un peuple tout court, et d’un peuple d’ailleurs gouverné. Pourquoi confondre les deux termes ? L’un dit : gouvernement du peuple. L’autre dit : condition populaire. Si le peuple catholique régnait, s’il s’agissait à son propos d’une démocratie véritable, le problème serait résolu sans effort (mais au pire sens) et l’autorité (mal constituée, mais constituée) n’aurait pas à « surgir » d’un jeu complexe et alternant de désignation par en haut et d’élection exercée sur un plan déjà patricien.
La démocratie n’est pas le peuple, c’est le gouvernement d’un peuple dont les membres sont comptés un par un : un homme, un vote, cet homme et ce vote étant réputés souverains et créateurs d’une souveraineté soit directe soit déléguée. On sait quel mal cette institution a fait à la Belgique après la victoire de 1918 : on y avait précédemment le vote plural ; le vote plural peut, dans son ensemble, être démophile, ami et bienfaiteur du peuple, son sauveur, son conservateur : il n’est pas démocrate, puisqu’il institue une autorité fondée non sur la quantité, mais sur la qualité, celle de chef de famille, d’époux, de père, de diplômé, de possédant, etc… Les qualités prévalent sur le nombre. En démocratie, le Nombre, par définition, ignore la Qualité, et la façon dont il prévaut sur elle ne naît pas d’une corruption, ni d’une crise, ni d’un abus : il est lié à la logique de son pouvoir.
Dans sa lettre, M. Paul-Albert Robert proteste contre la brigue. Et il a raison. Les beaux temps de la République romaine, patriciens dans l’âme, avaient la brigue en horreur. L’élection vraie, l’élection juste est celle qui n’est pas sollicitée qui jaillit comme un cri public vers le mérite ou la compétence : Ambroise évêque ! Ambroise évêque ! Ce n’est donc pas l’élection démocratique. Celle-ci, non contente de tolérer la brigue, en fait un devoir et une loi : notre scandaleux système de « déclaration de candidature », établit après le Boulangisme, interdit aux électeur d’aller spontanément, librement, naturellement, à l’homme de la circonscription qu’ils savent apte à les servir ; il faut que celui-ci soit allé dire à Monsieur le Préfet : je suis candidat. Quelle honte ! Mais quel aveu ! La démocratie bénéficie de l’ambition des candidats comme de la compétition des partis. Elle vit de cela, et de cela seul.
Certains auteurs, et des plus grands, entre les Maîtres de jadis, ont paru se montrer moins radicalement hostiles à la démocratie. L’autorité d’Athènes, dont l’histoire ne laisse pas d’être cruellement exemplaire, semble avoir fait hésiter un Aristote si rigoureux d’ordinaire. Il faut avouer que sa Politique n’est pas exactement le Traité de la science de la durée et de la prospérité des Etats ; il y manque, en plus d’un endroit, des distinctions indispensables. Le droit, le devoir, l’utile, le nécessaire, y semblent parfois confondus. Tels de ses disciples, comme saint Thomas d’Aquin sont bien plus nets. Non partout : son De Regimine Principum est un traité de l’action politique, c’est-à-dire d’une action qui ressortit, comme toute action, à l’éthique ; il ne traite pas de la STRUCTURE des Etats politiques. La Somme est autrement instructive à cet égard. Mais, de toute évidence Bossuet est en progrès sur Saint Thomas, comme Bonald sur Bossuet et notre La Tour du Pin sur Bonald. Sans la moindre foi au progrès, l’on est bien obligé d’avouer que des travaux persévérants conduits dans le même sens par des générations de hautes intelligences nourries des mêmes principes, dévoilent et dégagent de croissantes lumières.
Leur Père à tous, Aristote, paraît même en progrès sur lui-même quand on compare à sa Politique, défectueuse par moments, la lumineuse monographie découverte en 1890, intitulée : la Constitution d’Athènes, que d’autres traduisent : la République des Athéniens, où la matière proprement politique est distinguée par l’analyse philosophique de l’histoire, et isolée des questions latérales tirées de l’impératif moral. Bien que la déontologie médicale doive se mettre en règle avec le décalogue, il ne faut pas mêler les affaires d’éthique à des affaires d’anatomie. Ce petit livre inestimable, bienfait posthume d’Aristote à ses arrière-neveux, mériterait d’être lu et médité par les esprits que préoccupe le problème de la démocratie. Il fut l’objet d’un cours à l’Institut d’Action française de 1906, dans une chaire dite de l’Empirisme organisateur : c’est un des plus beaux souvenirs de notre jeunesse, alors expirante, et quels amis n’y voyons-nous pas assis sur le même banc,- de Lucien Moreau et de Jacques Bainville à Léon de Montesquiou, à Robert de Boisfleury, à Pierre Gilbert !
Il faudrait donc que cela serve. Répétons que la démocratie est la grande créatrice, excitatrice et stimulatrice de ce mouvement collectif, dénommé la lutte des classes. Je ne comprends pas comment M. Frossard peut opposer à cette évidence les réflexions marxistes sur « le patricien et le plébéien de l’ancienne Rome ». Car elles la confirment.
Très précisément, les conflits sociaux gréco-romains, les longues guerres des pauvres contre les riches, et la destruction de la Cité et de la Ville sont sortis de la démocratie. Avant elle, la coopération des classes se faisait tant bien que mal. Après elle, de cette démocratie politique et de son parti sortit l’institution canonique de leurs rivalités d’intérêt. Celles-ci auraient pu exister, mais elles auraient pu aussi ne pas exister, suivant le cas, les circonstances, les évènements… La démocratie les a rendues nécessaires.
Cela de tous temps. Il y eut des heures où les ouvriers du cuir de Limoge ont voulu obtenir des patrons du cuir un salaire supérieur ; il sonna d’autres heures où les mêmes ouvriers et les mêmes patrons, menacés par des industriels tchécoslovaques, ont fondé, toujours à Limoges, une entente sur le commun intérêt de leur travail, bien supérieur aux antagonismes de leurs classes. Cette union est naturelle dans un pays non démocratique. Elle est particulièrement difficile quand un pays comme le nôtre ou comme Rome décadente, est doté du régime politique du Nombre et de son vote : les partis naissants cherchent et trouvent dans les classes rivales ce qu’on peut appeler l’eau mère de leur cristal. Ce qui était accidentel, et fortuit, l’antagonisme social, devient régulier et constant, en vertu de la structure légale de la cité. C’est d’elle, en conséquence, que le mal vient ou, si l’on veut, qu’il devient mal chronique et constitutionnel. Un socialisme sans démocratie peut aboutir à une organisation nationale et sociale du travail. Le socialisme démocratique va, court, se précipite à la lutte des classes prolongée jusqu’à leur ruine. Comme la démocratie produit dans l’Etat absolument les mêmes effets que dans la société, elle est bien le mal et la mort. Une République peut être en règle avec les lois de la durée et de la prospérité des peuples, une Démocratie jamais.
On a vu de grandes Républiques durer et croître du moment qu’elles étaient en conformité avec les conditions héréditaires de la vie des Etats : leurs pouvoirs collectifs ont été longtemps productif et florissant. Cela ne s’est vu d’aucune Démocratie. Tous leurs débuts ont coïncidés avec la consommation et la dissipation des ressources, la dégradation et l’exagération de l’autorité, l’affaiblissement de l’Etat, et les empiètements de l’Etatisme, avec la centralisation en même temps que la décomposition. Les peuples les mieux doués, les pays les plus favorisés, ont tous reçu de la démocratie le même souffle de décadence qu’elle a répandu chez nous entre 1789 et 1939 : il y a le même siècle et demi de cette course à la mort chez le peuple d’Athènes, entre 490, l’année de Marathon, et 338, l’année de Chéronée ; encore, la guerre du Péloponnèse, qui accéléra ce déclin, était de 431 : plus près de la grande victoire que de la défaite définitive.
Encore cette démocratie était-elle tempérée par toute sorte de rudes défenses : esclavage, métèques, tirage au sort des archontes (et non leur élection comme on faisait des stratèges) et le fameux : « Qui est ton père ? Qui est ta mère ? Et le père de ton père ? » La flamme du verbalisme démocratique fut la plus forte que tout et plus destructive. En fait, rien n’a jamais tenu contre cette puissance de mort.
Le Play disait : « La monarchie dans l’Etat, l’Aristocratie dans la Province, la Démocratie dans la Commune. » Erreur patente, il faut le dire avec tout le respect dû à ce maître, erreur née d’une fausse symétrie. Que vaut la démocratie dans la commune ? Nos finances municipales, nos polices municipales, nos convulsions et nos léthargies municipales répondent qu’elle n’y vaut rien, et pis que rien.
L’expérience que la France en a faite est probante. Le Play voulait sans doute dire : République dans la Commune. Mais il savait fort bien que, heureusement pour elles, un grand nombre de petites communes, ayant pour maire un propriétaire terrien, parfois châtelain, sont de menues seigneuries constitutionnelles, qui ne connaissent même pas un statut républicain. Pour les grandes agglomérations, ce sont, ce doivent être des Aristocraties comme les Provinces, mais d’un caractère spécial : la bourgeoisie y est moins différenciée que dans les capitales de provinces, les grandes fortunes y sont moins personnelles, et cette réunion de foyers se rapproche davantage du type communautaire, le nom le dit assez bien, avec son prolongement non moins significatif de biens communaux. La Tour du Pin disait avec raison que la commune est la famille de ceux qui n’en ont pas, il entendait une grande famille au sens historique. Rien de démocratique dans cette commune-là ! Car lorsque la démocratie s’y introduit, avec le souverain suffrage égal et unitaire, on peut dire que ce bon fruit reçoit le ver qui le rongera.
Il me semble difficile de résister à ce corps d’évidences, qu’il serait possible de rendre plus clair encore.
Quant aux censures que les marxistes faisaient de la démocratie, M. Frossard en aurait-il été dupe lui aussi ? Je l’avoue : ce fut mon cas. Il y a fort longtemps et pour un temps très court.
Quelques conversations et quelques lectures de socialisme orthodoxe suffirent à me montrer que, si les Partis et les Classes y étaient hautement préférés aux « grues » métaphysiques dont parlait Paul Lafargue, le gendre de Marx, on n’en considérait pas moins le jeu naturel de la Démocratie comme le grand ressort de la lutte sociale et le meilleur engin qui pût servir aux camarades et aux militants. Preuve : le merveilleux emploi, de plus en plus socialiste, fait des scrutins démocratiques, depuis le retour des communards amnistiés (1880) jusqu’aux élections du front populaire (1936). Et cela se comprend : tout organisateur qu’il se prétende, le socialisme ne veut organiser le travail qu’au profit de l’égalité ; le socialisme marxiste est à fins égalitaires ; il tend à la démocratie politique. Qu’est-ce, au surplus, que l’égalité politique sans égalité sociale ? Une simple fiction. Les deux systèmes se soutiennent partout et ne peuvent se contredire sérieusement nulle part. On n’épurera le socialisme, on ne lui rendra une valeur naturelle et humaine qu’à la condition de le délivrer de toute politique démocratique. Alors, et alors seulement, cet égalitarisme extérieur ayant disparu, on pourra substituer à son égalitarisme intrinsèque les principes d’entr’aide et d’interdépendance qui sont la condition de la vie et des progrès de toute nation.
Le seul mot de démocratie crée un péril pour l’ordre et la paix. A l’exemple de Le Play qui, pourtant fort attentif au vocabulaire, voulut faire dire à ce mot ce qu’il ne dit point, La Tour du Pin eut, un jour, une courte hésitation, il inclina même à cet usage malsain. Armée de son merveilleux petit livre, Aphorismes de sciences sociales, notre jeunesse osa le rappeler à ses propres principes. Il eut la bonté généreuse de s’y rendre comme à la vérité. Pourquoi nos conservateurs et nos nationaux n’ont-ils pas fait comme lui ? Cette joie, ces hautes délices, cette béatitude d’être dans le vrai les auraient certainement consolés du plaisir qu’ils nous auraient fait.
M. Paul-Albert Robert invoque le prestige de l’histoire ecclésiastique en faveur de ce qu’il appelle « démocratique » et qui n’est point démocratique. Est-ce que ces vagues ressemblances, ces reflets approchés de la démocratie, n’ont pas été trop souvent capables d’imposer ou inspirer des déviations dangereuses ?
Comment peut-il bien comparer une grande société d’âmes comme l’Eglise, à nos sociétés charnelles ? Celles-ci ne sont point filles de notre volonté. Elles sortent de notre sang, de notre naissance : natio, le mot le dit. Alors, pourquoi éliminer, par suite d’on ne sait quelle timidité instinctive, le procédé naturel de la transmission du commandement, qui est l’hérédité physique, le même qui sert à transmettre les autres biens ? L’histoire est le panégyrique vivant des monarchies héréditaires, en particulier dans notre France. Quelle phobie en peut éloigner ? Et nos cent cinquante-deux années de démocratie parlementaire ou plébiscitaire sont-elles si brillantes qu’il faille se dire les uns aux autres : Comme on est bien là ! Et comme il fait bon d’y rester !
Tiré de « De la colère à la justice – réflexions sur un désastre »
De Charles Maurras
1942
De Charles Maurras
1942