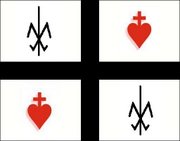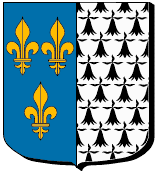DICTATEUR ET ROI
Charles MAURRAS
Table des matières
La dictature royaliste : ses principes........................................................................................................ 2
Le régime royal...................................................................................................................................... 2
Les libertés, en bas................................................................................................................................. 3
L'autorité en haut.................................................................................................................................... 4
Comparaison des deux régimes royaliste et républicain............................................................................ 8
Conséquences : la politique royaliste....................................................................................................... 9
1° La Question religieuse................................................................................................................... 9
2° Question militaire........................................................................................................................ 10
3° Questions économiques............................................................................................................... 10
Conclusion........................................................................................................................................... 10
Croiriez-vous que, dans la fièvre des premiers jours, j'étais presque devenu légitimiste, et que je suis encore bien tenté de l'être s'il m'est démontré que la transmission héréditaire du pouvoir est le seul moyen d'échapper au césarisme, conséquence fatale de la démocratie, telle qu'on l'entend en France.
Ernest Renan (Lettre du 14 janvier 1852)
Dictateur et roi a été rédigé dans l'été de 1899, peu de jours après les arrestations du 13 août. Un certain nombre de nos amis étaient prévenus de complot. Il nous avait donc paru juste, convenable et nécessaire, de répondre au défi de la Haute Cour par des entreprises nouvelles.
On avait jusque là beaucoup parlé de royauté, mais toujours en termes si vagues ou si expéditifs que le mot ne représentait rien de net à l'esprit ou figurait des images de l'archaïsme le plus pur. Il paraissait urgent de rendre des couleurs vivantes au nom d'une institution dont la nécessité se faisait sentir de plus en plus chaque jour à tous les Français réfléchis. Mon ami Frédéric Amouretti, que je consultai le premier, m'approuva et m'encouragea vivement. On verra, par mes notes, qu'il a collaboré à ce travail, et dans quelle mesure. La meilleure forme d'un acte de ce genre nous parut être une déclaration des écrivains royalistes, établissant avec clarté quel serait le rôle momentané et quelle était l'essence perpétuelle du régime monarchique traditionnel. J'entrepris aussitôt de rédiger un texte. MM. Charles Vincent et Jacques de La Massue furent nos premiers adhérents. Un suffrage du plus haut prix nous était venu dès la même heure : c'était celui d'un vétéran de la cause royale, homme de haute intelligence, d'un caractère ferme, d'un savoir étendu, M. Auguste Cordier, alors directeur du Nouvelliste de Bordeaux. La France et le roi ont perdu en lui un grand serviteur. Les nouveaux royalistes, alors bien inconnus ou bien contestés, n'oublieront pas les précieux encouragements qu'ils reçurent dès la première heure d'Auguste Cordier.
Un quiproquo fâcheux, suivi de quelques discussions toutes verbales (absolument en dehors de la direction du monde royaliste), se mit en travers de la publication projetée. De retard en retard, on traîna jusqu'à la fin du printemps suivant. L'Enquête sur la Monarchie commença à Bruxelles et continua à Paris. Or, comme elle était faite sur le même plan et selon les mêmes doctrines que Dictateur et Roi, le premier document devenait superflu. Il resta donc à l'état d'ébauche, qu'il arriva de mettre au jour de temps en temps pour satisfaire la curiosité d'un ami ou pour éclaircir quelque discussion. Mais plus d'une conversion royaliste fut hâtée et mûrie par cette lecture. Le jour où l'on renonça sérieusement à la publication immédiate, une voix dit : C'est dommage, c'était clair ! ... Jamais une oraison funèbre ne me fit autant de plaisir.
Voici l'essentiel de ce document :
Les adhésions nous viennent de tous les groupes de l'opinion et de tous les points du pays. Elles arriveraient plus nombreuses encore sans un malheureux préjugé : quantité d'antidreyfusiens et d'antisémites, patriotes aussi énergiques que passionnés, se représentent la Restauration monarchique comme un régime trop effacé, trop tempéré, trop parlementaire pour mettre fin aux entreprises des factieux. Par la déclaration que voici, nous nous proposons notamment[1] de détruire ce préjugé et de définir ce que nous entendons et avons toujours entendu par la Royauté.
Il faut que tous les Français en âge et en état d'apprécier une doctrine politique connaissent la Royauté dans la double fonction qu'elle doit exercer, l'une transitoire et l'autre constante : d'abord faisant justice des criminels d'État, procédant ensuite à la reconstitution et à la gestion du pays.
La dictature royaliste : ses principes
Les soussignés écrivains royalistes, parlant en leur seul nom, mais invoquant, outre les traditions et constitutions de l'ancienne monarchie française, les discours et lettres de M. le comte de Chambord, de Monseigneur le comte de Paris et de Monseigneur le duc d'Orléans, en particulier les récents manifestes de celui ci, affirment premièrement que le chef de la Maison de France leur apparaît Dictateur nécessaire autant que Roi légitime.
Ils affirment, secondement, que le gouvernement du Roi de France ne peut manquer d'être répressif et vengeur dans ses premiers actes de dictature, afin de pouvoir être réparateur dans ceux qui suivront.
Ils affirment enfin que la répression exercée par le roi évitera de multiplier inutilement les rancunes. Il ne doit pas se former en France un nouveau parti de vaincus et de parias. La vengeance publique doit frapper les meneurs et tous les meneurs, mais eux seuls : c'est la paix, c'est l'oubli qu'apportera le Roi aux séduits et aux égarés. Son aïeul Henri IV, qui ne s'attardait guère aux séditions du menu peuple, n'hésita point à faire exécuter cinquante mille gentilshommes d'une seule province, coupables de préparer la guerre civile. Ainsi l'action royale ne doit s'attacher qu'aux grands criminels, mais elle doit les rechercher avec une froide et méthodique énergie, sans autre sentiment que l'amour du pays et la haine des ennemis de la Nation. Après la Commune, on a fusillé des milliers d'ouvriers et laissé échapper les chefs : un Roi de France aurait frappé ces derniers sans miséricorde mais il eût épargné le peuple.
Le régime royal
La dictature royaliste ayant résolu cette crise, il nous reste à prévoir ce que sera le gouvernement normal du royaume.
Nous le concevons comme le régime de l'ordre. Nous concevons cet ordre comme conforme à la nature de la nation française et aux règles de la raison universelle.
En d'autres termes, ce régime nous apparaît comme le contre pied de celui que nous subissons.
Aujourd'hui, on rencontre la liberté et ses périls en haut, nous voulons dire dans les affaires capitales qui engagent l'avenir de la nation et la sûreté de l'État ; quant à l'autorité, dans ses plus extrêmes rigueurs, on l'a placée, bien inutilement ! en bas, dans les sujets où, au contraire, la discussion, la diversité, l'initiative de chaque citoyen seraient, non seulement sans périls, mais avantageuses ; on a mis cette autorité souveraine et décisive dans le moindre détail des rapports des particuliers avec l'administration !
Intervertir cet ordre, placer les libertés en bas, l'autorité en haut, c'est proprement reconstituer l'ordre naturel et rationnel ; la constitution royaliste, c'est donc proprement la constitution naturelle et rationnelle du pays enfin retrouvée ; et le règne du Roi n'est que le retour à notre ordre.
Les libertés, en bas
Il n'y a point de vexations soit légales, soit illégales, que l'Administration française ne se trouve permises contre le contribuable et l'administré. Il n'est point d'insolences que n'osent les bureaux contre les citoyens. Un César anonyme et impersonnel, tout puissant, mais irresponsable et inconscient, s'applique à molester le Français depuis le berceau. Soit qu'il vive seul, soit qu'il veuille s'associer, le citoyen français est assuré de rencontrer à tous les pas de son chemin le César État, le César bureau, qui lui impose ou lui propose soit ses directions avec ses prohibitions, soit ses marchandises avec ses subventions.
Celles des affaires publiques que le citoyen connaît le mieux sont soumises à la surveillance ou au bon plaisir de l'État. Sans l'État, un père de famille, un conseil municipal, un bureau de société, un simple comité de fêtes ne peuvent décider presque rien en ce qui les touche de plus près et qui les intéresse immédiatement. Associations volontaires, comme les sociétés morales et politiques, ou associations naturelles, comme la famille, la commune et la province, tous les rassemblements de citoyens sont tantôt frappés d'inertie par les lois de l'État, tantôt même interdits par le caprice des chefs temporaires de l'État...
Non seulement l'État ennuie et tracasse le citoyen français, mais il lui inflige des commodités dangereuses. Il le sert en des cas où celui ci devrait se servir lui même. Il le déshabitue de la réflexion et de l'action personnelle. Ainsi l'État endort et atrophie chez le citoyen la fonction civique. Le citoyen devient ignorant, paresseux et lâche. Il perd le sens et l'esprit public. Traité en mineur, il devient digne de retomber en tutelle. Les intérêts prochains de sa communauté ne le touchent ni ne l'occupent. Des curateurs gérant l'avoir communautaire, il les laisse faire ; il s'isole de ses concitoyens. Il retourne à la condition individualiste du sauvage et du primitif.
Par une suite naturelle de ce régime, des villes de dix mille âmes ne renferment souvent pas un seul de leurs citoyens qui soit digne d'elles. Pourquoi faire des citoyens, en des lieux où l'État centralisé prend à forfait toutes les besognes civiques ? Mais ces besognes, il est vrai que l'État les fait mal, étant mal outillé pour les faire. Nos différentes communautés glissent ainsi à une décadence profonde, où l'État lui même les suit : pauvre d'hommes, la France sera bientôt pauvre de tout.
Considérant que les âges de vraie et solide prospérité nationale furent, en France, ceux où le Pouvoir royal, indépendant et maître des attributions propres de l'État, n'empêchait point les différents corps, compagnies et communautés de la nation de gérer librement leurs intérêts particuliers ;
Considérant que la décadence de la Monarchie nationale suivit sous les Bourbons la décadence de ces corps, compagnies et communautés : chaque empiétements du pouvoir royal sur leur autonomie étant aussi marqué par l'amoindrissement secret de ce pouvoir ;
Considérant que ces éclatantes leçons donnés au Roi et à la France par huit siècles d'expérience historique ne seront point perdues pour la France ni pour le Roi :
Le Pouvoir royal ne peut désormais manquer de tendre, avec fermeté, quoique avec sagesse et moyennant les délais et précautions indispensables dans la pratique, à rétablir l'usage de ces libertés partout où l'intérêt supérieur de la Patrie et de l'État n'exigera pas le déploiement de l'autorité.
C'est à dire QUE :
Les familles s'organiseront comme il leur plaira. On testera comme on voudra. Les pères qui voudront constituer à la suite de leurs descendants des biens héréditaires, incessibles et insaisissables, en auront toute liberté. Reconnues enfin pour des associations naturelles, les familles pourront acquérir des droits analogues à ceux des citoyens, posséder en commun un avoir honorifique et moral comme un avoir matériel.
Les communes et les pays (ou arrondissements), par une suite de mesures libératrices prudemment sériées, deviendront maîtres de régler selon leur gré leurs affaires propres, disposant de leur ordre intérieur sans intervention de l'État, décidant des affaires qui sont familières ou qui peuvent l'être à chacun de leurs membres et n'étant bornés, dans cet honnête et raisonnable liberté, que par le bien commun et la sûreté du royaume.
Ces vastes régions qui s'étendent autour de nos grandes villes (Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Nancy, Toulouse, Rouen, Montpellier, Grenoble, Besançon, Limoges, Clermont, etc.) seront reconnues par la loi et délivrées du sectionnement départemental, qui est absurde et anarchique ; les territoires agglomérés autour de ces capitales naturelles obtiendront progressivement l'autonomie, en tout ce qui touche leurs affaires particulières, sans engager l'intérêt national ; de grands conseils provinciaux, sous le contrôle, supérieur mais éloigné, de l'État, concourront au réveil et à la renaissance du corps entier de la patrie que la politique jacobine a diminué.
Les associations professionnelles, confessionnelles et morales jouissant de la plus complète liberté, seront soumises au droit commun, et considérées comme des personnes civiles autonomes, faisant leur police elles-mêmes par cet esprit de corps qui est le principe de tous les progrès ; elles seront capables de posséder, d'acquérir, d'aliéner, d'acquitter des impôts, de payer des amendes et d'être même, en cas d'indignité légale, retranchées de la vie commune à temps ou à perpétuité.
Au résumé, le citoyen, dans toute la sphère où il est compétent et intéressé directement, dans tout ce qu'il a le pouvoir de connaître et donc de juger, est présentement un esclave. Le pouvoir royal lui rendra la disposition et la souveraineté de ce domaine qui lui fut arraché sans droit, sans utilité, et au péril même de la force de la patrie.
Voilà ce que fera le roi pour les libertés. Il les rendra aux citoyens. Il en sera le garant, le défenseur et le gendarme. Examinons ce qu'il fera pour l'autorité, ainsi chassée du détail intérieur de la vie civile.
L'autorité en haut
Il la relèvera, la définira, l'utilisera pour des fins purement nationales.
L'État français qui se mêle de tout aujourd'hui, même de faire des écoles et de vendre des allumettes, et qui, en conséquence, fait tout infiniment mal, vendant des allumettes ininflammables et distribuant un enseignement insensé, l'État est lui même impuissant à remplir sa fonction d'État. Il est abandonné aux représentants du pouvoir législatif. Les ministres ne sont que les commis et serviteurs des sénateurs et députés et ne songent qu'à leur obéir pour défendre leur portefeuille. Selon une énergique formule, « l'électeur mendie les faveurs chez le député, qui les mendie chez le ministre, lequel mendie les votes du député, qui mendie les suffrages de l'électeur »[2].
Une classe de citoyens, profondément méprisée du pays entier, fait métier, fait commerce de l'influence et de l'intrigue ; sénateurs, députés, courtiers électoraux, c'est hasard si l'on trouve un caractère indépendant sur mille individus de cette profession. Ceux d'entre eux qui passent pour avoir les mains propres sont des sots avérés. Le matin même de l'élection Loubet, un de nos maîtres pouvait écrire que le futur élu du Congrès brillait surtout par l'insuffisance intellectuelle.
Toujours ignares et bornés, souvent faméliques et corrompus, voilà les maîtres de la France. On nous dit qu'on les changera. Changer le personnel ne servira de rien. Une Assemblée composée, par hasard, de gens éclairés serait nécessairement remplacée, à bref délai, comme l'Assemblée de 71, par une horde d'agitateurs, captateurs du suffrage populaire. Si ces nouveaux venus sont honnêtes à l'arrivée, ils seront gâtés par le mécanisme du régime. Le comte de Paris l'avait observé : de pareilles institutions corrompent leurs hommes, quels qu'ils soient.
Qu'est donc un tel gouvernement ? Un fantôme, un jeu de syllabes ! Ses divers chefs se valent les uns et les autres pour se surpasser et se vaincre jamais définitivement. Dix, vingt ou trente mois, c'est tout ce que dure à peu près la victoire d'un de leurs groupements ministériels ; un cabinet républicain, chargé de subvenir aux plus graves nécessités politiques et économiques de la nation, ne peut pas durer davantage. Quel grand ou petit magasin, quelle échoppe de fruitière ou de savetier survivrait à ce changement continuel et systématique de direction ? Quelle industrie ne serait ruinée si le personnel directeur en était bouleversé tous les dix, vingt ou trente mois ?[3]
Aucun ministre n'a le temps d'étudier les services qu'il est censé diriger. C'est à peine s'il les connaît de vue. Le pauvre homme laisse donc ses chefs de bureau décider de tout. De temps en temps sur l'injonction de quelque groupe parlementaire, il les bouscule avec une passion ignorante et violente. On passe ainsi de la Routine à la Révolution, sans moyenne heureuse possible. Ni contrôle sérieux, solide, personnel, ni sûre tradition. Aussi notre administration ne fait elle plus de progrès : trop heureuse quand elle évite la déchéance.
Car cette direction ministérielle instable est, de plus en plus, divisée contre elle même jusqu'à la folie. Point d'unité de vues entre les membres du même ministère. Point même d'unité de vues chez le même ministre. Il a, d'une part ses amis politiques à combler, d'autre part ses adversaires à apaiser. La manoeuvre parlementaire opprime ainsi sa politique générale ; celle ci est subordonnée absolument à celle là. Comme la plupart des ministres sont tirés de la classe honteuse qui vit de nos budgets, comme ils n'ont d'existence que par la classe de leurs souteneurs électoraux, les ressources de la nation sont mises au pillage. La dépense inutile et d'origine électorale augmente chaque jour, et les recettes se réduisent du même mouvement. Défense nationale, industrie et commence de la nation, tout est sacrifié aux petits intérêts de nos fabricants de scrutins. Si l'on creuse un port, c'est pour eux. C'est pour eux qu'on trace une route. C'est pour eux que l'on construit un chemin de fer. L'intérêt général n'y a qu'une part misérable. Notre puissance financière s'épuise à satisfaire la clientèle électorale des députés et des sénateurs influents, absolument comme notre puissance politique à asseoir fermement et à défendre obstinément l'influence de ces gens là. Impuissant pour le bien public, le régime, quand il a la prétention d'être fort, dépense ses ressources fiscales et ses instruments de police à établir ses hommes ou à consolider l'anarchie qui règne avec eux.
Par ces gaspillages, et aussi faute d'une direction compétente et continuée, le commerce diminue et l'industrie baisse malgré la crue factice déterminée par l'Exposition. L'agriculture ne vend point ou vend mal ses produits, et le prestige politique de la France suit la même dépression que sa puissance économique. Un pouvoir sans vigueur, qui administrait faiblement l'armée et ne la commandait point du tout, l'a laissé insulter depuis deux ans entiers. Ce pouvoir, dans l'ordre diplomatique, ayant, non sans incohérence, engagé l'entreprise de Fachoda, n'en a pu sortir qu'à notre honte commune. L'alliance russe[4] a même cessé de paraître dans le vocabulaire des conversations de l'Europe.
M. de Bismarck prévoyait sans doute plusieurs de nos malheurs présents quand il fit tout pour nous vouer au système républicain. Bismarck n'ignorait pas que la force d'un État suppose l'unité de vues et l'esprit de suite, la cohésion et l'organisation. Et comme le régime de la République n'est que l'absence d'une volonté directrice et d'une pensée continue au centre du pouvoir, il sentait combien ce régime divise et condamne au changement perpétuel le peuple qui s'y abandonne.
On nous dit bien, chez les républicains parlementaires et aussi chez les plébiscitaires, que ce pouvoir instable et débile repose sur une assise ferme. L'assise qu'ils trouvent si ferme, c'est la volonté nationale, s'exprimant par les élections législatives ou les plébiscites. D'elle vient, puisqu'en elle réside, disent ils, l'autorité gouvernementale. Les mêmes hommes qui refusent au citoyen le droit de traiter des questions qu'il connaît et de gérer les intérêts qui lui sont les plus proches, les mêmes hommes qui refusent à l'électeur municipal le droit de changer une fontaine de place ou d'ouvrir un chemin sans la permission de l'État, prêtent, par la plus étonnante des fictions constitutionnelles, au même citoyen et au même électeur le pouvoir absolu de faire un choix sensé et d'émettre un avis utile sur les questions les plus lointaines, les plus profondes et les plus épineuses de la politique générale : cet électeur, ce citoyen, dont on suspectait tout à l'heure la compétence en des sujets fort modestes, est tout d'un coup censé posséder les lumières des classes de l'Institut, puisqu'on propose à ce citoyen de choisir entre la politique radicale et l'opportuniste, entre l'autoritaire et la libérale, entre le socialisme et le capitalisme, et qu'il a le droit d'orienter par son choix, par son vote, la législation, la haute justice, la diplomatie, l'organisation militaire et navale du pays tout entier !
Jamais une si grande chimère n'a été réalisée avec probité. Au lieu de s'en plaindre, il faut voir qu'elle est irréalisable et prévoir que, même indépendant, même probe, même intelligent, l'électeur sera toujours incompétent sur la plupart des sujets qui lui seront soumis. Cette incompétence le rend ou violent et aveugle, ou hésitant et versatile, souvent même ceci et cela tout à la fois.
L'électeur français passe son temps à délivrer des blancs seings à des inconnus, sans autre garantie que la nuance des affiches sur lesquelles les candidats ont inscrit leurs déclarations. Ce système intéresse, excite, détermine les partis d'opposition, même honnêtes, à plus forte raison ceux qui ne le sont pas, à provoquer le plus grand nombre possible de scandales et de catastrophes, de manière à causer le plus de mutations possibles à chaque renouvellement électoral. L'intérêt de parti remplace ainsi le bien public. C'est ainsi que l'on décompose la France.
Qu'y devient l'État ? Un esclave. Esclave des Chambres. Esclave des partis parlementaires, des coteries électorales. Esclave même de ces événements imprévus qui, sous un tel régime, déchaînent avec la panique, des changements d'opinion, donc de personnel et de direction, mais qui sont justement ceux qui exigeraient, au regard du salut public, le maximum de fermeté, de stabilité et de possession de soi même : on est conduit nécessairement à tout ébranler quand il faudrait tout affermir ; on destitue Varron à l'heure précise où il le faudrait accabler, même incapable et même indigne, des témoignages de la confiance de l'État.
Par ce triple et quadruple esclavage à l'intérieur, l'État français tend à la servitude extérieure ; les autres États ne tolèrent son indépendance apparente que pour le mieux laisser fléchir, dégénérer et fondre de lui même.
Considérant que les écrivains soussignés se savent pénétrés des nécessités politiques qui peuvent échapper à leurs concitoyens et qu'ils agissent en fondés de pouvoirs et aînés de la Race, dans le plein exercice des devoirs et des droits qui leur sont conférés par les malheurs publics.
Considérant qu'ils sont conscients de l'obligation de veiller et de pourvoir au salut commun ;
Considérant que le salut commun, condition de tous les droits, impose un devoir essentiel envers la communauté nationale ;
Considérant que la communauté nationale, la Patrie, l'État ne sont point des associations nées du choix personnel de leurs membres, mais oeuvres de nature et de nécessité ;
Considérant aussi que l'unité de la France n'est pas formée par un certain nombre d'individus vivant à un moment donné et ayant en commun certaines idées, ou certains goûts éphémères, mais bien par un certain nombre de familles se développant d'âge en âge et ayant en commun certains intérêts permanents : intérêts du sol à défendre, de la race à perpétuer, capital économique et moral à développer ;
Considérant que l'absence fatale de toute autorité permanente sous le régime républicain menace et compromet ces profonds intérêts qui sont généralement la force française, des volontés, des idées et des sentiments propres aux Français ;
Le citoyen français abandonnera par un fidéicommis solennel et irrévocable[5] à la branche survivante de la famille Capétienne l'exercice de la souveraineté. Par là, l'autorité se reconstituera au sommet de l'État. Le pouvoir central sera délivré des compétitions des partis, des assemblées, des caprices électoraux : l'État aura son libre jeu. Sous sa responsabilité, dans l'indivisible intérêt de sa famille et de son peuple, le Roi, chef de l'État, régnera et gouvernera. Son Arbitraire conscient, légal et responsable, et celui de ses successeurs assureront l'unité, la constance, la permanence des desseins, moyennant l'assistance des hommes compétents, siégeant dans les conseils techniques et dans les assemblées locales.
Expliquons le détail de cette fonction de l'État
Il n'y aura plus de Parlement à l'anglaise. L'expérience parlementaire, tentée de 1815 à 1830 et de là jusqu'en 1848 par les plus honnêtes gens et même les plus éclairés, a échoué. S'il s'est accompli des progrès considérables sous la Restauration et le Gouvernement de Juillet ; si l'on peut dire que notre capital moral et économique s'est refait à ce moment là et que nous vivons de cet ancien capital, l'histoire fait voir clairement que le bien s'opéra malgré le régime parlementaire, grâce à l'esprit politique des princes ou à de véritables dictatures ministérielles (le duc de Richelieu, Villèle, Guizot) : dictatures qui n'étaient du reste possibles que sous la monarchie.
Il faut au Prince, une responsabilité définie. Comme dit Renan : « La royauté nous montre une nation concentrée en un individu ou, si l'on veut, en une famille, et atteignant par là le plus haut degré de la conscience nationale, vu qu'aucune conscience n'égale celle qui résulte d'un cerveau », quelle que soit, au reste, la valeur propre de ce cerveau.
Les ministres seront responsables devant le prince. Tous les ans, une délégation des assemblées provinciales se réunira à Paris pour voter et contrôler les finances communes. Paris sera le siège ordinaire de la Cour et le rendez vous permanent de tous les grands corps de l'État.
Nous appelons ainsi tous les corps dignes de ce nom : Chambres industrielles et commerciales, Union des corporations, Société des agriculteurs de France, Institut, etc. Les conseils du Roi seront naturellement recrutés dans ces hautes Chambres techniques, véritables témoins de l'action et de la production de la France, n'ayant rien de commun avec cette cohue de polissons, d'intrigants et de bavards qui, sous prétexte d'un mandat électoral, grouillent dans le Palais Bourbon et le Luxembourg : étrangère au Pays, sépale du Pays, tant du chef de ses intérêts que du chef de ses sentiments.
Le pays producteur, le pays travailleur sera ainsi mis en contact perpétuel avec le pouvoir politique. Celui ci, devenu organe spécial, sera le maître de sa spécialité. On le conseillera et on l'éclairera, mais au nom du principe de la division du travail, on ne l'entravera point dans ses actes propres. Ces conseils techniques du trône, ces assemblées professionnelles, pourraient former plus tard les éléments de quelque Sénat nouveau ; mais, outre qu'un Sénat, création historique, ne s'improvise point, mieux vaut peut être aussi que les conseils techniques, expression de compétences particulières, soient tenus normalement isolés les uns des autres, pour que chacun exerce pleinement son autorité respective : au besoin l'on pourra soit les assembler en des congrès, soit en former certaines commissions mixtes dont le Roi, en personne ou par ses commissaires, sera le modérateur, l'initiateur et l'arbitre.
Quant aux usurpations des assemblées locales ou professionnelles sur les droits régaliens de l'État, un châtiment déterminé par les lois du royaume les rendra impossibles ou les réprimera avec la dernière vigueur. De même le Prince pourra t il être invoqué en dernier appel, comme arbitre suprême et comme grand juge, par les citoyens qui se trouveront lésés par les pouvoirs inférieurs. Son rôle sera de départager, de concilier et de modérer les uns et les autres. Il ne se mêlera pourtant de leurs affaires qu'à la dernière extrémité et sur l'appel des intéressés, car des soucis plus importants l'appelleront ailleurs.
Au résumé, l'État, représenté par le pouvoir royal dans toutes les hautes et lointaines questions de politique générale qui échappent à la compétence et à la réflexion des particuliers, sera rétabli dans ses droits naturels et rationnels, qui sont l'Indépendance et l'Autorité. Le citoyen les lui abandonnera d'autant plus volontiers que, étant lui même dans l'impossibilité d'exercer ces pouvoirs nécessaires, il est aujourd'hui le premier à souffrir, dans sa fortune aussi bien que dans sa fierté, de l'absence de protection et de direction nationale.
L'État aura des conseillers, mais n'aura désormais qu'un Maître.
Ainsi seront conciliées dans le nouveau royaume de France, conformément à ses traditions nationales, une autorité et des libertés qui sont, au même degré, nécessaires.
Comparaison des deux régimes royaliste et républicain
Nous avons un gouvernement républicain et une administration monarchique : le bien public exige que cet ordre paradoxal soit renversé.
L'administration doit être républicaine, puisqu'elle doit servir le public ; le gouvernement, monarchique, puisqu'il doit le gouverner. Ce qui importe, en effet, à la vie des administrés, c'est la liberté ; ce qui importe à la vie politique d'une nation, c'est l'autorité, condition de l'esprit de suite, de la décision et de la responsabilité.
L'autorité en haut, en bas les libertés, voilà la formule des constitutions royalistes.
L'absurde République une et indivisible ne sera plus la proie de dix mille petits tyrans invisibles et insaisissables ; mais des milliers de petites républiques de toute sorte, républiques domestiques comme les familles, républiques locales comme les communes et les provinces, républiques morales et professionnelles comme les associations, s'administreront librement, garanties, coordonnées et dirigées dans leur ensemble par un pouvoir unique et permanent, c'est à dire personnel et héréditaire, par la même puissant et sage, étant intéressé au maintien et au développement infini de l'État.
Il est à observer que cet État si fort dans sa propre fonction gouvernementale sera très faible pour rien entreprendre contre le citoyen. Car, au lieu que le citoyen de la République française se trouve réduit à ses pauvres forces individuelles pour lutter contre le mécanisme énorme de l'État, le citoyen du nouveau Royaume de France se trouve engagé dans toutes sortes de libres et fortes communautés (sa famille, sa commune, sa province, sa corporation, etc.), qui emploieront leurs forces à le sauver de tout arbitraire injustifié.
Les garanties du citoyen dans l'État républicain sont absolument théoriques, mais sont déduites, il est vrai d'une théorie (les Droits de l'homme) qui conduit à méconnaître les droits de l'État : dans la pratique, elles s'évanouissent absolument. Respectueuse des droits supérieurs de l'État, la théorie monarchiste confère au citoyen des garanties pratiques, des garanties de fait : celles ci ne sont pas théoriquement inviolables, mais elles sont pratiquement très difficiles à violer.
La liberté est de droit sous la République, mais elle y est seulement de droit : sous la royauté nationale, les libertés seront des faits, certains, réels et tangibles.
Conséquences : la politique royaliste
De cette autorité royale, ainsi superposée aux libertés civiques sortira nécessairement plus d'aisance privée et plus de force nationale.
Nous allons essayer de dire comment les trois questions les plus épineuses de la politique française, pourront selon toute vraisemblance, être réglées.
1° La Question religieuse
Par la liberté d'association et la renaissance des grands corps, compagnies et communautés autonomes, on tendra nécessairement à la suppression du budget des cultes et de celui des universités. Les universités et les cultes doivent suffire à eux mêmes à leurs besoins.
Le catholicisme, religion traditionnelle de la France, recouvrera tous les honneurs auxquels il a droit. Un gouvernement d'illettrés et de furieux pouvait seul les lui marchander et, par exemple, exclure de la Sorbonne Louis XI et de Gerson l'enseignement de la théologie. Ce régime de petitesse sera clos. Mais il est évident que la liberté intellectuelle la plus complète régnera sur le sol français. Loin de troubler l'oeuvre de recherche scientifique et philosophique, il faut que l'État en seconde et en facilite le cours, au moyen de libéralités et de dignités accordées à tous les hommes qui s'y seront distingués. D'ailleurs, sur le ferme terrain de l'organisation et de la direction des sociétés, il ne peut y avoir conflit entre les esprits religieux et les esprits scientifiques. La politique catholique exclut l'idéologie révolutionnaire qui est en horreur chez les positivistes ; quant à la politique positiviste, ses sympathies et ses affinités avec le catholicisme sont évidentes. L'État aura seulement à pratiquer envers lui même le devoir étroit de ne point favoriser ni subventionner, comme l'a fait l'inimitable République présente, des théories qui ont pour fin prochaine ou pour objet immédiat le renversement de l'État : l'anarchie politique et ses théoriciens seront donc surveillés, et s'il existe des confessions religieuses qui tendent à cette anarchie, elles seront soumises à cette surveillance, qui est de droit naturel. Il en serait de même pour les confessions qui tendraient à desservir l'intérêt national au profit de l'Etranger.
2° Question militaire
Le roi de France constituera, lui seul ayant autorité pour entreprendre une telle réforme[6], une armée de métier, signe vivant de sa force et de notre unité, aussi nombreuse, aussi exercée que possible. Le reste des contingents nationaux serait soumis à six ou huit mois d'exercice, avec appel d'un mois, de deux ans en deux ans. Le principe de la division du travail condamne le système de la nation armée, fondée en théorie sur une grave erreur historique (les volontaires de 1792) et obtenu pratiquement par une détestable contrefaçon du système allemand.
3° Questions économiques
L'usure sera poursuivie. Réprouvant toute philanthropie hypocrite, on défendra le peuple laborieux contre les agitateurs et les démagogues aussi bien que contre les agioteurs. Les abus du capitalisme, étant le prétexte de l'agitation révolutionnaire, seront observés avec vigilance. L'industrie nationale, le travail national seront protégés contre le travail et l'industrie de l'étranger, mais aussi contre les spéculateurs cosmopolites établis au milieu de nous. Un peuple sain et fort élimine de lui même ces parasites. La « bonne politique » lui rétablira ses finances. L'administration, arrachée enfin au contrôle révolutionnaire du Parlement et à la somnolente routine des bureaux, pourra devenir un auxiliaire utile.
Responsables de ces administrations devant la Couronne, les divers ministres sont pressés d'y introduire les réformes souhaitées du public. Une police financière sera constituée sur le type de la police politique, non pour ralentir les transactions, mais pour épargner aux citoyens ces ruines subites dont le pays entier subit le contrecoup. La propriété sera défendue et encouragée sous toutes ses formes, depuis le simple livret de caisse d'épargne, organe élémentaire de la défense personnelle, jusqu'à la propriété territoriale, qui forme la base physique de la patrie.
Conclusion
Quoi qu'on ait prétendu, cet espoir d'une renaissance française n'est point une chimère, car la vitalité du pays, si elle est menacée, ne parait pas très gravement atteinte. Moralement, physiquement et financièrement, nous sommes très riches encore ; mais on gaspille nos richesses et on les administre mal. Celui qui guérira les deux plaies politiques qui nous ont été faites depuis cent ans, panarchisme administratif, anarchisme d'État, l'État sans maître, l'Administration maîtresse de tout, guérira le principe de nos misères. Nous sommes royalistes parce que nous considérons que la royauté est seule capable d'opérer l'une et l'autre médication.
Un parlement, créé par l'élection, dépend aussi de l'élection. Un Parlement ne confère donc à l'État ni l'autorité ni l'indépendance. Mais un chef d'État plébiscité se trouve dans les mêmes conditions qu'un Parlement. Si on le nomme à temps, quelle prime on offre aux plus vastes agitations électorales ! Et quel trouble périodique dans l'État ! Le président des États Unis d'Amérique n'ose, même dans les conjonctures d'une très haute gravité, prendre une seule décision, trancher un débat important, donner un ordre précis, aussitôt qu'approche la date de l'élection présidentielle : le malheureux craint, en effet, en fournissant un avis quelconque, de s'aliéner un groupe quelconque d'électeurs[7]. Si on nomme à vie ce président quelle prime on offre à l'assassinat et, en tout cas, quelles révolutions, quelle agitation, quels transports de fièvre malsaine on prépare pour l'instant de sa succession ! C'est le régime qui perdit la malheureuse Pologne ; car au lieu de réduire et de circonscrire la compétition gouvernementale à une classe, à une caste, à une famille, il l'étend au pays entier !
De plus, ce dictateur n'est responsable que pour un temps, au maximum le temps de sa vie complète. S'il évite les fautes et les imprudences d'un ordre trop direct et trop immédiat, rien ne l'empêche de compromettre, de grever et de sacrifier l'avenir du pays. Tel est le propre de la dictature personnelle. Voilà pourquoi nous demandons le pouvoir souverain non pour un homme, non pour un peuple, mais pour une famille représentante de ce peuple et elle même représentée par un homme.
Nous espérons qu'on ne nous répondra point de sornettes sur le hasard de la naissance. Comme si l'élection n'avait point ses hasards ! Comme si ces derniers hasards n'étaient point pires que les premiers ! On élève un Dauphin en vue du trône ; on ne fait pas l'éducation d'un candidat à la présidence de la République. Jamais d'ailleurs, ni en aucun pays, non point même chez les tribus les plus sauvages, le hasard naturel de l'hérédité n'éleva sur le trône une succession de médiocrités comparables à la série Carnot - Périer - Faure Loubet. Ce quadruple néant fut cependant porté au fauteuil présidentiel par le choix de deux assemblées unies en Congrès solennel.
Le système de l'hérédité monarchique suppose, d'après un sentiment naturel de prévoyance domestique (qui peut manquer une fois mais qui se retrouve neuf fois sur dix), que le chef de l'État ne jouera point facilement l'avenir de sa dynastie et dans tous ses calculs appellera la prudence et la réflexion. Ces vertus vraiment paternelles, propres aux pères et aux chefs de famille, ont précisément distingué la Maison Capétienne dans son oeuvre de constitution de la France. Ses princes se sont appliqués, d'un règne à l'autre, à ne point trop gagner dans une seule entreprise, de crainte de trop perdre ultérieurement comme il est arrivé à des Napoléon. Mais, à la différence de Napoléon 1er et de Napoléon III, qui tous deux laissèrent la France plus petite qu'ils ne l'avaient trouvée, les descendants d'Hugues Capet ont tous transmis leur héritage tel qu'ils l'avaient eu de leurs devanciers ou augmenté de quelque province.
Si donc, en vue de nous éviter les inutiles et périlleuses compétitions électorales, pour prévenir le retour périodique des agitations et enfin pour avoir la paix, si, disons nous, l'on convient de confier le pouvoir à une famille, il est évident que c'est à la plus digne, à la plus ancienne et à la plus illustre des familles françaises que doit revenir cet honneur. Ni la famille Bonaparte, quelque glorieux qu'ait été son rôle historique, ni aucune autre maison française, quelques services qui aient été rendus à la nation, n'offre de garanties comparables à celle de la race des Capétiens. Elle n'a même point d'aînée en Europe, et elle est à nous. Bien mieux que cela, elle est Nous. Son histoire est la nôtre. La figure de notre terre porte partout son nom et son souvenir. Comme Ivan le Grand fut surnommé le Rassembleur de la terre russe, cette dynastie peut être appelée Rassembleuse de la terre française[8]. Sans elle, il n'y aurait point de France. Cela est d'une rigueur absolue.
Les souvenirs de Rome ont fait l'unité italienne. La réalité de la race et de la langue germanique, unie aux traditions de Charlemagne et du Saint Empire, a fait l'unité allemande. L'unité britannique est résultée de la condition insulaire. Mais l'unité française, oeuvre de politique, de la plus souple, de la plus longue et de la plus ferme politique autoritaire, résulte et résulte exclusivement de desseins continués pendant 1 000 ans par la Maison de France. Cette unité, si solide qu'elle semble aujourd'hui spontanée et naturelle, est l'oeuvre unique de nos princes. La nature s'était contentée de rendre cette unité possible, non nécessaire, ni fatale : ces princes l'ont formée et façonnée comme un artisan donne un tour personnel à quelque matière choisie.
Dynastie véritablement terrienne et paysanne, puisqu'elle a arrondi sa terre et composé notre pays, mais dont on ne peut dire au juste si c'est l'audace ou la sagesse qui l'ont mieux caractérisée ! La politique des Hohenzollern, si fatale à la France, mais si avantageuse à tout le peuple allemand, n'est elle même qu'un bon décalque et un plagiat raisonné de la politique des Capétiens.
Bien que partie d'un certain point du pays, cette dynastie populaire et militaire s'est peu à peu étendue jusqu'aux confins de l'ancienne Gaule ; sa tradition s'est amalgamée à toutes les nôtres. Les libertés que nous font fait perdre cent ans de césarisme et d'anarchie sont celles que nos pères conquéraient autrefois sous le règne des Capétiens et que ceux ci reconnaissaient en de solennelles consécrations. La royauté et les libertés sont mortes ensemble. Tout annonce qu'elles devront renaître de concert.
Il est une France idéale, disent dans leur mauvais langage, les rhéteurs, d'origine anglaise, allemande, helvétique, qui président à l'Église républicaine. Nous sommes citoyens d'une France réelle. Par la France, nous entendons une réalité plus chère et plus belle que tout, et non une idée nuageuse. Pulcherrima rerum, comme disait de sa propre patrie le Romain : nous entendons le sol et ses variétés, le sang et ses riches nuances, les traditions, les intérêts, les sentiments. Nous songeons aux maisons, aux autels, aux tombeaux où dorment de saintes dépouilles. Cette France réelle, étant ce qu'elle est et ayant besoin de Monarchie, postule, par définition, ayant été ce qu'elle fut, la Monarchie du chef de la Maison de France. Celui ci, étant ce qu'il est, correspond à ces convenances et à ces nécessités. Le peuple est prêt à le sentir. Puissent les esprits cultivés reconnaître ce rapport naturel d'une grande nation et d'une longue souche de princes, en comprenant enfin la formule de notre avenir national ;
« Ce que nos ancêtres ont fait par coutume et par sentiment, le poursuivre nous mêmes avec l'assurance et la netteté scientifiques, par raison et par volonté ».
[1]Ce mot « notamment » est de la main de Frédéric Ammouretti.
[2]Les morts qui parlent, par le vicomte de Vogué.
[3]Ces délais ont été portés à trente-six ou quanrante mois parles long ministères Waldeck-Rousseau, Combes et Clémenceau; leur ridicule insuffisance persiste, comme l'atteste bien l'état de nos grands services techniques, la Marine par exemple. (Note de 1909).
[4]Cette alliance nous avait amenés à une sorte d'entente avec l'Allemagne (18 juin 1895, Kiel) qui aboutit au krach de Fachoda. A notre tour, par nos coquetteries inconsidérées avec l'Angleterre, nous avons contribué à égarer la Russie vers Moukden. (Note de 1909).
[5]On peut nous objecter ici que ce fidéicommis ou cet abandon sera lui même un acte de la volonté populaire et que nous rentrons par là dans le système que nous condamnons. Cette objection d'ordre logique ne nous sera point faite par des logiciens corrects. Autre chose, en effet, est une doctrine de mythologie politique en vertu de laquelle la volonté populaire est souveraine, par ce seul fait qu'elle est la volonté populaire, autre chose est un acte déterminé de cette même volonté, s'exerçant une fois, et, au lieu d' être prise elle même pour fondement, fondée sur la raison et l'intérêt public. Tant vaudront cette raison et cet intérêt, tant vaudra cet acte particulier de la volonté populaire : il sera donc logiquement antérieur et supérieur à l'acte de cette volonté.
[6]Est-il utile de répéter que dans un sujet aussi délicat, la volonté du Dictateur et Roi s'exerce avec plus d'indépendance encore que dans les autres-? Nous n'indiquons que le principe. En République, les intérêts de l'État et ceux de l'armée sont divergents et rivaux. En Monarchie, ils sont alliés et convergent. L'État peut s'y préoccuper
d'avoir une armée plus solide et de meilleure qualité en même temps que d'alléger le fardeau économique et social du militarisme.
[7]Les six lignes depuis « Le Président » sont de Frédéric Amouretti.
[8]Phrase de Frédéric Amouretti.